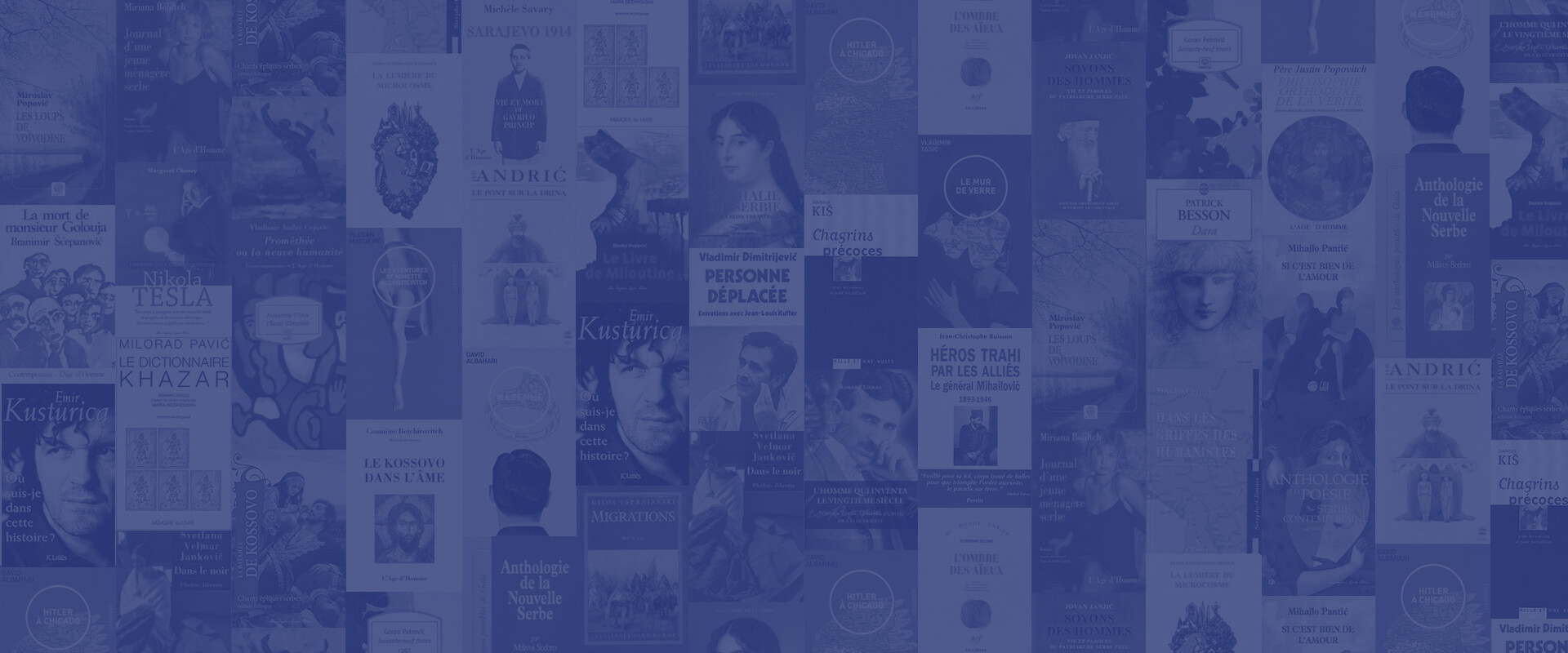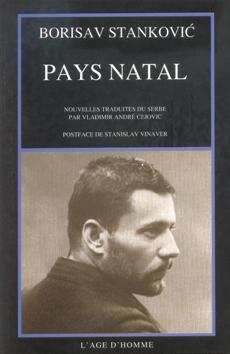Bora Stankovic, par S. Vinaver
|
J’ai partagé avec Bora des années et des instants. Il me semble, parfois, que ce sont ces instants Puisque j’aimais, de la manière la plus profonde et la plus chaleureuse, le grand écrivain au verbe rude Rastko1, Crnjanski 2, et Mom?ilo Nastasijevi? 3. Je me plongeais dans la substance vivante de ces mots – toute pleine d’entrelacs et de noeuds – horrifié par les prétendues « incorrections grammaticales », et surtout par l’amplitude frémissante des sentiments. […] D’ailleurs, nous n’arrêtons pas de bégayer! Quand nous pensons que nous sommes clairs, les plus clairs possible – même alors nous sommes obscurs! Voyez comment chez Gunduli? 4 les verbes s’amoncellent pour exprimer l’hésitation, l’indécision, et dire le plus possible: les sens pressentent à l’infini, et ils voudraient tout capter à l’aide des mots, comme avec un compas – tandis que la grammaire et la logique s’y opposent selon l’habitude classique des cultures seigneuriales conscientes d’elles-mêmes. Sans cesse, elles exigent des portées limitées, de la précision.Des textes écrits de Bora, je suis passé à ses récits oraux: même si ce n’étaient que des mots sans suite, tout juste sortis de la gorge. Je saisissais aussi leur contexte. Nous oublions si souvent les circonstances qui accompagnent les mots. Nous avons des rythmes irrésistibles dans le domaine du décasyllabe. Là, tout coule. Le décasyllabe vainc toutes les répugnances et les embarras de l’esprit. Il coule comme les eaux et les rivières, il ruisselle comme les sources et les fontaines, et s’éloigne de son cours lent et irrépressible vers l’éternité. Un demi-million de nos décasyllabes seulement est imprimé, alors nous pouvons et devons imaginer le danger effrayant qui menaçait notre langue de couler et s’écouler en décasyllabes. Tout nous échappait. Le rythme était impérieux. Tout était indifféremment exprimé par et pour le décasyllabe et se noyait dans le décasyllabe. Notre verve épique est assurément une verve épique élevée, scandée, et qui a sa direction propre – qui pourrait la contenir! Mais, voyez, les Français non plus ne savaient plus où ils allaient avec leur alexandrin! C’est alors qu’ont surgi chez nous des écrivains aux sentiments passionnés, aux lourdes discordances, aux souffrances âpres – dans des domaines où la langue ne s’écoule pas toute drapée de décasyllabes. Ces auteurs, ex abrupto, voulaient exprimer autre chose! Tel fut Jaša Ignjatovi?, tel fut Nastasijevi?, Rastko Petrovi?, tel fut Crnjanski. Et tel fut, plus que tout autre, Bora Stankovi?. Chez lui, un seul mot, un seul sentiment, un seul cri, domine: c’est l’individu troublé qui voit, écoute, et sent en dehors du troupeau. Ce n’est pas un cortège uniforme qui se perd à l’horizon comme une nuée d’oiseaux. Ici, tous les instants de notre vécu individuel (même monstrueux) revendiquent leurs droits, ici nous voyons, nous savons, nous sentons: chaque instant et geste de la vie a son fatum, peut l’avoir, doit l’avoir, et au-dessus de chacun, si modeste et insignifiant soit-il au regard de l’Histoire, au-dessus de l’individu, s’ouvrent (dans des moments prodigieux) les cieux de bénédiction et de malédiction, les abîmes et les profondeurs de la vie vécue, réelle et inestimable; l’homme existe en dehors de l’Histoire, en dehors du temps de l’horloge aux roues dentées et au mouvement monotone. Au premier abord, je pensais que je pouvais deviner le parangon des phrases et des bégaiements de Bora. Tout d’abord, il m’avait semblé qu’il s’agissait du taedium vitae antique d’Horace (le spleen, la profonde nostalgie, l’incurable langueur) – les Grecs étaient des gens très curieux: leur curiosité (selon la définition d’Aristote de « l’homme ») ne pouvait jamais, et par rien, être rassasiée. D’où leur incapacité à ressentir ce taedium, ou ce que l’empereur Salomon appelait la « vanitas ». C’est pour cela qu’en contrepartie ils étaient contraints au bavardage et à de sempiternelles jongleries de rythmes! Mais cette langueur, qui n’a-t-elle pas habité?! Elle a habité Byron, et Baudelaire, et Flaubert. Flaubert, qui plus est, avait pris en dégoût tous les mots en général, les mots en tant que tels, et, en additif à son Bouvard et Pécuchet, il composa son Dictionnaire des idées reçues. Flaubert voulait (ce grand maître de la langue!) nous dégoûter du langage: que nous reniions tout discours, que parler nous soit une torture, que tout énoncé nous répugne. Chez Bora, il n’y a pas un seul cliché. Ce qui est cliché – il ne le sent pas. Il le rejette avec mépris, comme un vulgaire mégot! Frémissant, et la gorge serrée, il incarne la résistance au cliché, à la phrase banale, à la tournure qui a perdu sa vivacité, il est le pourfendeur du « lieu commun ». Tout, chez Bora, est vécu. Tout ce qu’il n’a pas vécu, il ne veut pas s’en approcher, même de loin. Toute chose s’appartient. Cette âpre langueur, chez Bora, venait du fait que, pour lui, toute chose devait être exprimée telle qu’elle est, sans déviation vers le facile, le vil, le doucereux ou l’incertain: sans l’habileté de la verve qui n’a jamais atteint la cible de rien d’essentiel. Cette âpre langueur venait de la terrible difficulté d’exprimer la vie vivante, de faire que cette vie-là soit vécue au coeur même de l’écriture, plus encore peut-être qu’au moment où elle a pris naissance, et elle venait aussi du risque omniprésent de tomber dans l’utilisation banale des mots et de la syntaxe. La grammaire est un jeu qui nous mène à l’impasse. Que de fois Bora ne m’at- il pas dit: « Écrire est plus difficile que labourer. Écrire est incommensurablement difficile. Il faut tout dire. Tout dire. Et comment le dire? » Aligner les mots, bavarder, arranger les expressions? Non, ce n’est pas cela. Ce n’est jamais cela. Flaubert lui aussi le savait, bien sûr, et l’a maintes fois répété dans ses oeuvres, et sa Correspondance. Comment, et quoi exprimer? Si vous frappez dans les tournures bien agencées, selon les règles, – vous vous dégoûtez de vous-mêmes! Tout va à l’eau, en rythmes, en envolées, en associations! Doit-on se laisser aller à tout cela? Il faut rendre uniquement ce qui est essentiel. Et là, on bégaie d’excitation, de l’importance de son rôle, du jeu qui surpasse tout jeu. Car c’est une gageure que d’exprimer avec des mots simples l’homme et la vie. Dans les tavernes et auberges des bords du Danube, Bora rencontrait de petites gens avec des buts de vie ratés et des chemins faussés. Chacun portait en lui sa blessure de l’âme, fondamentale, le « trauma » de Freud. Chacun se resserrait autour de sa plaie ouverte. Chacun d’eux était le martyr qui souffre quand il contemple cette plaie sacrée, sans laquelle il ne peut vivre, qui fait de lui ce qu’il est, et ce qu’il n’est pas. Chacun prenait soin de sa blessure, non pour s’en guérir, mais pour la sauvegarder, et ainsi se sauvegarder soi-même. Celui-là ne pouvait plus s’imaginer sans elle. Elle était devenue l’axe de sa vie, et son rayonnement douloureux. Tous les jours, à chaque heure du jour. Même en rêve, il revenait à elle. Tout le reste, hors cette blessure, était pour lui insignifiant et secondaire, jusqu’au rire, grotesque et discordant. Chacun prenait soin de sa sainte douleur avec amour, avec mille précautions: en soi et pour soi. Cette douleur était son unique et inestimable trésor, sa joie et sa misère sans prix. Pour celui-là, elle était tout et plus que tout. Jamais elle ne l’abandonnait, plus fidèle que la femme aimée. Comparé à une telle fidélité, l’amour de l’aimée est chose brève et passagère. Et, comme les amis du fidèle barbier de Bagdad des Mille et une Nuits, chacun de ces ratés avait son histoire, sa propre façon de parler, son désir, sa nostalgie, sa plainte et sa chanson! Que sont, par rapport à ce trésor exaltant, tous les trésors terrestres si fragiles et éphémères! Les richesses amassées et les plaisirs factices des snobs dans l’oeuvre de Marcel Proust – et dans le monde entier, si on élargit l’idée ! Parmi toutes ces survies tragiques des bords du Danube, Bora aimait particulièrement les vies sombrées dans des voluptés à jamais perdues, comme celles des petits Juifs vivant sur les berges, les vendeurs de cacahuètes, les petits artisans, les vendeurs de graines, les faux intermédiaires, les camelots et boutiquiers aux marchandises inexistantes. Ils appartenaient à la grande phratrie du banquier Benzoni Bulia – qui, d’une voix enrouée, secouait la Bourse et lorgnait en direction de Budapest et de Vienne et de leurs établissements financiers bruissants de chiffres – mais, selon les mots de Bora, ils possédaient dans leurs veines plus que tous les Benzoni dans leurs coffres de la Wertheimer. Ils possédaient leur terrible et lancinante douleur, sans un moment de répit, ils possédaient leur vie inassouvie, qui couvait ardemment en eux et en ceux qui étaient comme eux. C’était la soif de la plus grande maladie qui soit, celle du destin, de sa propre fatalité. Enfin, Bora méprisait « l’Europe pourrie » de Djura Jakši? 5 – c’est de lui, sans doute qu’il a pris l’expression – avec le même mépris que Byron envers l’Europe d’un bigot « monarque boutiquier ». Bora avait en horreur les philistins et les géomètres, les instruments de calcul dans le coeur et le cerveau. Il pensait avec épouvante à l’Européen contemporain – comme à un être dénué de tous les sentiments qui nourrissent la vie âpre et belle, qui sont l’amande dans l’écale de la vie. Il jugeait que l’Europe s’était muée en un album de ces petites vignettes que les enfants achètent pour les décalquer. Les Européens avaient perdu – disait-il – le sens du vécu, le sens du monde qui nous entoure, le sens du printemps, du ciel, du bruit des fontaines et du bleu des cieux. Cela, passe encore, peut avoir un certain charme, jusqu’à un certain point, pourquoi pas. Mais ils avaient perdu aussi le sens des choses prétendument plus sérieuses. Raphaël lui répugnait, pour lequel se répandait chez nous, à Belgrade, venant on ne sait d’où, l’opinion que toute l’Europe se reflétait en lui et qu’il en était, voyez-vous, le sommet. C’est-à-dire le monde et ses mystères, ses pressentiments et ses appréhensions – dans le lisse et vide Raphaël? « Je préfère encore – me disait Bora, au département d’art, devant les statues de Meštrovi? 6 – je préfère les gâteaux des pâtissiers décorés d’un coeur et d’un petit miroir. » |
|
Bora haïssait, d’une manière instinctive, le rhéteur de notre littérature, Bogdan Popovi?, et tous les mensonge se refusait à elle. Pourtant le mensonge,lui aussi, a ses délices!
En littérature, à cette époque, Bora n’aimait que nous, les « modernistes », et avant tout Raka Drainac qu’il avait une fois couvert de baisers, au café des « Trois Chapeaux », lui baisant même la main contre tous les usages, et malgré son renom de grand écrivain! À ma question provocante (pour lui soutirer une réponse): « Alors, Bora, tu es d’accord avec le comte Léon Tolstoï, qui dans son grand âge, a chanté, dans ses récits et légendes populaires, l’hymne au moujik russe, car, selon lui, il était le seul à avoir de la morale et à verser des larmes lorsqu’on prononçait devant lui le mot « âme » (ah, l’âme!)? » – Bora, d’un geste de dégoût de la main, sans un mot, a balayé le comte et ses larmes. Il n’aimait pas non plus les afféteries avec l’âme. Il aimait la vie et son gouffre, cruelle et crue, sans succédané. Bora méprisait même le mot d’« intellectuel » – qu’il prononçait avec une irrésistible grimace. Toute la dévotion et la bigoterie du Tolstoï tardif, tout ce qui émeut et serre la gorge chez Jean-Jacques Rousseau, chez Romain Rolland, et particulièrement chez le chouchou de « l’élite », Rabindranath Tagore, qu’on éclairait du feu de Bengale de la tendresse poétique et du mysticisme serein (auquel Bora tirait la langue comme un enfant) – tout cela, Bora le qualifiait d’anéantissement intellectuel des grands sentiments humains, des peurs, des angoisses, et pire encore. Il refusait l’âme pleurnicharde et la bigoterie saupoudrée de sucre. Elle lui levait le coeur. Il ne pouvait ni ne voulait concevoir la vie bien au chaud dans le giron de la mère. Il avait en aversion tous ceux qui s’enflammaient pour des rêves creux. Il voulait à tout prix quelque chose de rugueux et de magique dans la vie, qui nous donne à la fois la force de la résis210 tance et l’inspiration pour nos rêves, qui nous tienne en éveil dans une douce atmosphère de conte pour peu qu’elle soit tragique. La vie sans amertume était pour lui une vie sans goût. Je pense que les Turcs, et même la « langueur turque », il a fini par les détester, dans un moment de clairvoyance inspirée: parce qu’ils aimaient trop les sucreries. Maintenant – me dit-il – cela aussi, je le vois clairement. Dans la douceur des sucreries, on perd ses dents, tout ce qui est dur, tout ce qui est mâle. Les gens qui se pourlèchent, qui caressent et cajolent leurs sens, les hommes qui veulent assouvir leur sensualité au milieu des roses et des romarins, l’écoeuraient: l’huître doit éternellement souffrir du grain de sable d’où grandira, en secret, sa perle. Il estimait qu’il devait y avoir le plus de mauvaises herbes possible. Il insistait: qui veut en finir au plus tôt avec ce qu’il ressent, s’en débarrasser, n’en est pas digne. Ah! ceux qui sarclent sans arrêt! Alors que pour vivre un sentiment, quel qu’il soit, le toucher, le sentir, une vie ne suffit pas! Il faut que passent des jours et des années – pour que nous ressentions réellement la souffrance. Il y faudrait cent vies. « Cen-ent vies! » – répétait-il en étirant et allongeant le mot. C’est peu une vie! Et même cent vies, peut-être – c’est peu! Trop peu! Tout est peu – pour ce grain de vie qui exige des océans de temps autour de lui! Bora aimait uniquement ces hommes auxquels une vie ne suffit pas pour porter et protéger quelques germes lourds et âpres de la véritable essence du sentiment. Il aimait rencontrer et coudoyer des hommes de cette trempe, sur le chemin de la vie et du rêve, sur le « chemin de l’illusion » de Tin Ujevi? 7, qui n’est illusion que de nom. Il les cherchait, et les trouvait partout. Il pensait que c’est chez nous qu’on en rencontrait le plus. En eux était cette immensité poétique, qu’il appelait parfois « langueur turque », et qui, en réalité, est dans toute véritable et instinctive poésie lyrique. Elle est aujourd’hui plus que jamais présente aussi dans la littérature occidentale, de Proust à Faulkner. Le comité du prix Nobel, lui-même, s’est attaché à cette façon de voir. Tout le monde, aujourd’hui, est d’accord avec Bora: c’est lui qui avait raison. Les grands écrivains occidentaux ont enfin trouvé en eux la force de repousser ces mur- mures rêveurs au verbe facile, qui coulent, coulent, édulcorés à la saccharine, avec éloquence et sans effort, encouragés par les gratifications financières et le goût atavique de l’homme pour la rhétorique. La rhétorique montre la vie sous un aspect facile, résolu, bien ordonné et sans mystère, la vie saisie par le regard jusqu’à sa fin, dominée jusqu’à sa fin. C’est pourquoi Verlaine a proposé « qu’on lui torde le cou ». Caché en embuscade dans la ruelle de sa véritable poésie maudite, Verlaine a voulu étrangler la rhétorique élégante. Peut-être même l’a-t-il achevée, cette noble personne?Je questionnais souvent Bora à propos de Goethe. Il le connaissait à travers les écrits des différents « Bogdan » – comme il le disait luimême. Goethe, lui aussi, il le voyait d’un mauvais oeil – bien que son Werther, même pour les Balkans, fût une goutte d’eau vivifiante, dans nos saintes et fiévreuses coutumes, fixées depuis toujours. Je lui dis: « Goethe cherchait avec curiosité à parfaire une certaine sensualité – mais plus tard, il s’efforça de s’en débarrasser, pour éprouver d’autres sensations – pour ne pas se réduire à une seule et unique manière de sentir. Goethe ne fuyait pas les sentiments, il réclamait même avidement de nouvelles crises et souffrances du coeur. Il est mort, non pas une fois, mais mille fois. Il s’emportait continuellement, grâce à quoi il a évité la folie. Il se délivrait de chaque souffrance par son chant, en la célébrant dans ses vers, jusqu’à épuisement du chant. Et pourtant après chacune de ses folies, Goethe se lançait dans de nouvelles. » Bora refusait le salut. Sur Goethe, après ces paroles, il s’exprima encore plus durement.Je me souviens d’un de ses gestes: un jour, alors que nous étions en face du Théâtre de la Ville, dans la rue qui descend vers la Skadarlija 8, il me dit: « Vas-y, continue, j’ai quelque chose à faire ici, je te rattraperai. » Ce jour-là, il était en rogne contre le Théâtre de la Ville et son directeur (à cause de certaines circonstances financières, sujet auquel il était très sensible). Et, par vengeance, cette nuit-là, il eut un geste digne d’un garnement de Clochemerle, sur le bâtiment même du Théâtre! Peut-être cela semblera-t-il mesquin et vulgaire aux pieux adeptes des grands gestes. Bora avait recours, en toute occasion, à la vie, et quand il se trouvait devant quelque chose d’irrésistiblement concret, il lui semblait que là était la réponse la plus profonde et la seule possible. Il détestait le salut, le méprisait. Il haïssait quiconque voulait fixer des buts, des limites et des bornes aux sens et aux sentiments. Les sens et les sentiments doivent être – sans limites. Tous. Combien même ils semblent petits, insignifiants. Ce n’est qu’une apparence. Il faut leur donner de l’espace, du temps, une terre. Du passé et de l’avenir!Il détestait la catharsis d’Aristote (le salut par le secours de l’art). Vous direz: Bora et la catharsis! Bora et Aristote! Oui. Bora et Aristote, et la catharsis! Cela n’est pas réservé à des titulaires de chaire qui savent prononcer un mot étranger, et point final! Évidemment, il avait pour tout cela ses vigoureuses et savoureuses expressions du peuple. Des expressions, direz-vous, très différentes. C’est qu’il réagissait, de la moindre fibre, à ces notions essentielles de l’art et de la poésie, sur ce que les Grecs avaient déjà découvert dans les eaux troubles de leur temps, – car il ne vivait que pour la poésie, la trouvant, qui plus est, là où personne ne la cherchait: dans chaque grain de vie. Aujourd’hui, on affirme que l’atome lui-même est fait de grains! Pour Bora, toute la vie était une suite infinie de grains! Il n’aimait pas l’art grec – ce que les Bogdan appellent l’art grec. Pensez donc! Toutes ces statues si impudiques, à la blancheur marmoréenne. Il ne savait pas, à son époque, qu’autrefois elles étaient peintes. Là, Bora était plus authentiquement inspiré que Goethe et Winckelmann, ces admirateurs de la froide et inhumaine blancheur. Bora voulait que les statues soient vivantes, avec les couleurs de la vie. C’est ce qu’il ne cessait de me faire sentir, avec beaucoup de prodigieuses, et, direz-vous, surprenantes réflexions. La pierre froide lui répugnait. Il aimait la pourriture du vivant, la vie qui se consume. Je parle des statues – car, dans le département d’art (où se déroulaient toutes ces discussions) nous étions de partout entourés par les statues de Meštrovi?. Sur les statues grecques, il s’exprimait de cette façon concernant la couleur, mais aussi d’une manière beaucoup plus drastique, grossière, à la limite du juron, à propos des rondeurs et de certaines proportions. Il reprochait à tous les musées du monde d’exposer ces statues de nus et d’inciter les hommes et les femmes – particulièrement les femmes – à la concupiscence, qui n’est ni naturelle, ni convenable. Et, tout comme les statues lisses, il détestait les hexamètres bien agencés et réguliers de la poésie grecque, – oh! comme il haïssait tout ce qui est lisse, qui n’est pas rugueux, qui est uniforme et plat, tout ce qui ment effrontément en prétendant que la vie est harmonieuse et ordonnée, et, ce qui est pire, qu’elle doit être ainsi. Pire encore: que nous sommes d’accord avec cela. Personne n’est d’accord avec cela – me disait-il.Il rêvait d’une littérature, si je puis la nommer ainsi, faite de sèves rares et précieuses: un immense chêne humain, avec de profondes racines ramifiées dans la terre et un faîte majestueux, mais qui est blessé, et qui recouvre et protège sa plaie, jour et nuit, d’une sève résineuse odorante, son propre sang. Cette sève s’écoule goutte à goutte, et sourd de l’être tout entier, du tréfonds originel le plus sensible. Du plus précieux de son être, là où est l’instinct de vie. Sa sérénité, sa confiance, sont blessées. Mais la nature s’est rebellée. Combien est plus vivifiante cette sève que toutes les grappes de fruits qui font ployer les branches. Que toutes ces pommes et poires, dons d’une généreuse et tendre nature, dans d’idylliques vergers. C’est cette sève qui est précieuse et pérenne. Or, on la tenait pour quelque chose de négligeable. Une telle littérature exige une ferveur créatrice absolue. C’est cela la véritable pérennité.Pour finir, je dois évoquer ces mots rudes et rugueux, sans lesquels nous ne pouvons pas penser à Bora. Ces mots, en réalité, sont des mots de pudeur, des mots exprimés sous le couvert de la pudeur. Il se protégeait avec eux, comme avec une feuille de vigne. Il ne voulait pas avouer: qu’il ne pensait et rêvait qu’à une haute et ardente poésie. Par ces mots, il se défendait de la déplaisante curiosité humaine: afin que les gens ne pénètrent pas son mystère, ne le divulguent pas, et ne profanent ainsi ce qu’il portait en lui de plus sacré. par Stanislav Vinaver, 1952 * Bouillant critique littéraire, poète et essayiste (1891-1955). Il fut le chef de file des « modernistes » dans la période de l’entre-deux-guerres.1. Rastko Petrovi?: poète et romancier serbe (1898-1949).
2. Miloš Crnjanski: poète et romancier serbe (1893-1977). 3. Mom?ilo Nastasijevi?: écrivain serbe (1894-1938). 4. Ivan Gunduli?: poète ragusien (1589-1638). 5. Djura Jakši?: poète romantique serbe (1832-1878). 6. Ivan Meštrovi?: sculpteur croate (1883-1962). 7. Tin Ujevi?: poète croate (1891-1955). 8. Vieux quartier de Belgrade, fréquenté par les artistes. |